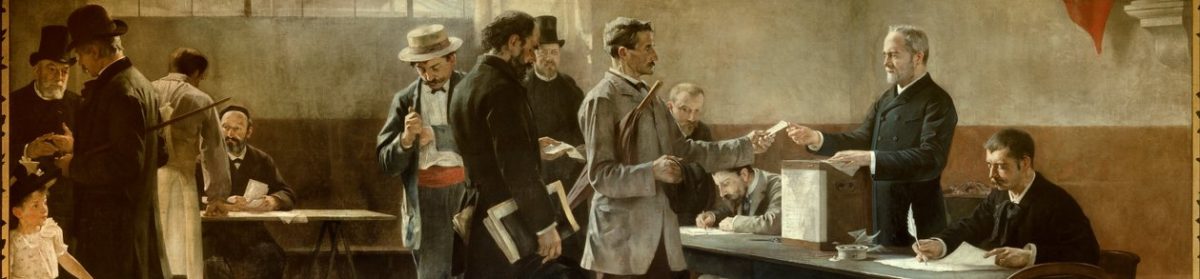Le 3 octobre 2025 (Décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025), le Conseil constitutionnel a inscrit un nouveau chapitre à l’interminable feuilleton de l’exécution provisoire des sanctions d’inéligibilité avec cette fois la résolution d’une QPC « au carrefour de plusieurs problématiques clés du droit électoral », pour reprendre les termes employés par Romain Rambaud lors de sa transmission par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel. Était en cause, dans cette affaire, une question portant sur la conformité à la Constitution du III de l’article 195 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie dont l’application conduit à ce que les élus aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie puissent être déclarés démissionnaires par le haut-commissaire lorsque leur inéligibilité est constatée postérieurement à leur élection. Le requérant reprochait à ses dispositions d’une part, le fait que les recours formés contre l’arrêté n’ont pas de caractère suspensif et d’autre part, le fait que ces dispositions peuvent être applicables y compris lorsque l’inéligibilité résulte de l’exécution provisoire d’une décision de justice qui n’est pas définitive. Ainsi, outre la question récurrente du bien-fondé de l’exécution provisoire des sanctions juridictionnelles d’inéligibilité, dont l’affaire Marine Le Pen est l’illustration la plus vive, se pose ici également d’épineuses questions quant au statut particulier des élus de la Nouvelle-Calédonie dont les attributions laissent penser qu’ils se trouvent dans une situation analogue à celle des membres du Parlement pour lesquels l’inéligibilité n’est effective que lorsqu’elle résulte d’une décision de justice devenue définitive. Lue à la lumière de l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur l’application des décisions d’inéligibilité visant les parlementaires européens – dont le régime se rapproche de celui des parlementaires nationaux –, la solution rendue par le Conseil constitutionnel en faveur de la conformité à la Constitution des dispositions contestées semble particulièrement discutable, en particulier eu égard à l’horizon ouvert par l’accord de Bougival en faveur de la création d’un « Etat de la Nouvelle-Calédonie ».
Sans entrer dans les détails de l’affaire – qui fera l’objet d’une note à paraître prochainement à l’AJDA –, nous pouvons successivement retenir les points suivants.
Une analyse opportune des conditions de recevabilité de la QPC
Dans ses conclusions, le rapporteur public du Conseil d’Etat, Frédéric Puigserver, fait état des obstacles qui auraient pu être opposés à la transmission de la QPC, tout en marquant une volonté claire que celle-ci puisse être posée par son aptitude répétée à surmonter ces obstacles.
Se posait en effet tout d’abord la question du délai de dépôt de la QPC qui intervient très tardivement après l’introduction du litige qui en est l’objet. En effet, celui-ci résulte de l’arrêté pris par le haut-commissaire le 29 novembre 2024 par lequel celui-ci a déclaré démissionnaire d’office l’ancien président de la province des îles loyauté et membre du congrès, Jacques Lalié. Or, la QPC a été introduite par un mémoire complémentaire au recours au fond seulement le 29 avril 2025, soit bien au-delà des deux mois de recours prévu – bien que de façon erronée – par l’arrêté du Haut-commissaire. Le rapporteur public estime néanmoins que ce moyen nouveau qu’est la QPC peut être recevable en dépit de son caractère tardif eu égard au « rapport de la QPC au temps qui n’est pas celui de n’importe quelle autre cause juridique ». Ce dépôt tardif a pu d’ailleurs être inspiré par la décision 2025-1129 QPC rendue le 28 mars 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a validé sous réserve la possibilité d’appliquer une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire aux élus municipaux.
Cela renvoie au deuxième problème de recevabilité posé par cette QPC et qui, là aussi, fut surmonté par le rapporteur public. S’agissant d’une QPC visant une disposition de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le fait est que celle-ci a forcément déjà été contrôlée par le Conseil constitutionnel en application de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution. Cela ressort notamment de la décision 99-410 DC ce qui fait théoriquement obstacle à la transmission de la question. Le rapporteur public a cependant pu estimer qu’un changement de circonstances de droit justifiait un nouvel examen de la constitutionnalité de la disposition contestée du fait, d’une part, de la loi dite Sapin II de 2016 et la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017 instituant le caractère obligatoire des peines complémentaires d’inéligibilité pour tout crime et de nombreux délits et, d’autre part, de la décision 2025-1129 QPC eu égard à « sa portée ». L’appréciation du rapporteur public sur ce deuxième point peut toutefois être discutable, la décision 2025-1129 QPC apportant un éclairage sur la jurisprudence constitutionnelle quant à la manière dont il peut analyser la problématique de l’exécution provisoire des sanctions d’inéligibilité, sans pour autant modifier substantiellement l’analyse qui peut être faite quant aux conditions d’application de la disposition contestée. Aussi, on notera que dans sa décision, le Conseil constitutionnel, tout en admettant le changement de circonstances résultant de l’entrée en vigueur des lois de 2016 et de 2017, n’a en revanche pas retenu sa propre jurisprudence comme étant de nature à caractériser un tel changement. Cela illustre en tous les cas la forte détermination du rapporteur public à ce que la question soit effectivement posée au Conseil, notamment au regard du moyen particulièrement sérieux que constitue l’atteinte alléguée au principe d’égalité devant la loi dans l’application de la sanction d’inéligibilité selon que l’on soit parlementaire ou membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Une appréciation discutable par le Conseil constitutionnel du moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant loi
Le moyen avancé ici repose en substance sur le fait que selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (v. notamment sa décision 2009-21S D), comme juge chargé de constater la déchéance des parlementaires, la sanction d’inéligibilité d’un député ou d’un sénateur ne peut conduire à sa déchéance qu’à partir du moment où la sanction est définitive ce qui s’oppose à ce que l’exécution provisoire puisse ici produire le moindre effet. Les requérants interrogent par conséquent le bien fondé de la différence de traitement entre les parlementaires nationaux et les élus aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels la sanction d’inéligibilité s’applique lorsque dans l’attente d’une décision définitive, le juge en ordonne l’exécution provisoire.
Rappelant l’argumentaire exposé dans sa décision 2025-1129 QPC pour justifier l’existence d’une telle différence de traitement avec les élus locaux, le Conseil constitutionnel énonce selon une formule que l’on pourrait qualifier de maladroite que « seuls les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale » (§17) et qu’à ce titre, ils se trouvent dans une situation particulière justifiant la différence de traitement dont font l’objet les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
L’analyse paraît alors doublement discutable :
D’abord en corrélant le régime « de faveur » dont bénéficient les parlementaires avec l’exercice de la souveraineté nationale. Si le raisonnement pouvait se tenir à l’égard de la comparaison opérée avec les élus locaux – encore que l’on peut s’interroger aujourd’hui à l’heure de la décentralisation sur leur propension à représenter également à leur niveau le peuple –, il est éminemment discutable, inapproprié, voire même dangereux lorsque l’on évoque les attributions des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. De fait, on rappellera que l’esprit de l’Accord de Nouméa était précisément d’affirmer le principe d’une « souveraineté partagée » entre la France et la Nouvelle-Calédonie dont les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont censées être les dépositaires. Laisser entendre que « seul » le Parlement national participe à l’exercice de la souveraineté pourrait renforcer le sentiment selon lequel la Nouvelle-Calédonie serait une collectivité comme une autre alors même que la Constitution lui accorde un titre particulier et que son statut est le fruit d’un accord politique tripartite. Le signal envoyé au moment où se joue l’avenir de l’accord de Bougival n’est donc pas des plus heureux…
Par ailleurs, l’effort de raisonnement par analogie quant aux attributions des membres du Parlement et de ceux du congrès de la Nouvelle-Calédonie qu’avait pu réaliser le rapporteur public a pu être repris dans les motifs de la décision du Conseil, mais avec une solution sans appel : bien que les membres du congrès puissent voter des normes ayant force de loi et contrôler l’action du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en engageant au besoin sa responsabilité (3 gouvernements ont ainsi pu se succéder en application de ce dispositif durant l’actuelle mandature), le Conseil constitutionnel estime que cela n’est pas comparable. La solution semble, pour le coup, radicalement différente de l’analyse proposée par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 juillet 2025 relatif aux conséquences d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire sur le mandat d’un représentant au Parlement européen, et confirmé récemment au fond dans son arrêt du 17 octobre 2025, les deux ailes du palais royal avançant pour le coup selon une logique différente.
En complément de cet argument, les requérants ont pu par ailleurs soulever devant le Conseil une autre hypothèse illustrant le caractère inconstant de l’application provisoire des sanctions d’inéligibilité. Il ressort en effet de l’article 109 de la loi organique relative à la Polynésie française, que l’inéligibilité à l’assemblée de la Polynésie française, lorsqu’elle est le fait de décisions juridictionnelles, est effective seulement lorsque celles-ci sont passées en force de chose jugée ce qui, par conséquent, remet en cause l’application d’une décision non définitive assortie de l’exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel va néanmoins éluder ici le moyen en soulignant le fait que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas régies par le même statut et que le législateur organique peut librement adopter des règles différentes en ce qui concerne leur régime électoral, ce qui pour le coup vide de sa substance l’invocation d’un moyen fondé sur l’atteinte au principe d’égalité devant la loi…
Le Conseil constitutionnel va par ailleurs curieusement prendre position sur la jurisprudence que devrait suivre le Conseil d’Etat en ce qui concerne le caractère suspensif du recours contre les arrêtés du haut-commissaire déclarant la démission d’office.
Un arbitrage surprenant en ce qui concerne la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de démission d’office
Au soutien de sa demande d’inconstitutionnalité, le requérant contestait le caractère non suspensif du recours formé contre l’arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire du fait de son inéligibilité. Outre l’atteinte au droit à un recours effectif, il estimait également que cela viole également le principe d’égalité devant la loi en ce que les élus municipaux dont la démission d’office est prononcée par le préfet du fait de leur inéligibilité peuvent bénéficier du caractère suspensif de leur recours eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat renforcée par l’interprétation a contrario de l’article L236 du code électoral. Le Conseil constitutionnel avait semblé alors faire de ce principe un élément à même de justifier la constitutionnalité de l’exécution provisoire des décisions d’inéligibilité frappant les élus locaux dans sa décision 2025-1129 QPC. En revanche, une telle interprétation ne paraissait pas pouvoir être applicable dans le contexte néocalédonien ce qui avait conduit à ce que la démission d’office de Jacques Lalié comme président de la province des îles Loyauté donne lieu dans la foulée à l’élection d’un nouveau président, en l’occurrence Mathias Waneux. Le rapporteur public du Conseil d’Etat n’était néanmoins pas convaincu du caractère sérieux du moyen invoqué par le requérant au soutien de la transmission de la QPC estimant, d’un côté, que la référence faite par le Conseil constitutionnel à ce trait caractéristique en ce qui concerne la démission d’office des élus municipaux serait surabondante et non déterminante pour la déclaration de constitutionnalité, et de l’autre, de l’intérêt limité d’un tel caractère dès lors que le cœur du problème réside dans le caractère non suspensif des recours engagés contre la décision du juge pénal d’assortir de l’exécution provisoire la sanction d’inéligibilité qu’il prononce.
De façon logique, le Conseil constitutionnel a pu écarter également ce moyen en estimant « sans incidence sur l’exercice des voies de recours contre la décision de condamnation » les modalités de contestation de l’acte par lequel le haut-commissaire en tire les conséquences. Mais il a pu également, de façon surprenante, infirmer l’analyse faite par le rapporteur public en ce qui concerne le caractère non suspensif du recours formé contre cet arrêt, le Conseil considérant formellement « qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que ce recours a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté » (§29 de la décision). En vérité, cette affirmation a pu être, de façon exceptionnelle, fondée sur une jurisprudence du Conseil d’Etat postérieure à la QPC, qui plus est une jurisprudence énoncée dans une ordonnance de référé suspension rendue le 22 juillet 2025 au sujet de deux autres membres du congrès déclarés démissionnaires d’office. Le raisonnement suivi par le juge des référés était alors de faire valoir la transposition du régime contentieux applicable aux contestations électorales régi par l’article 199 de la loi organique – prévoyant le caractère suspensif du recours – aux recours formés contre les arrêtés du haut-commissaire en matière de démission d’office. Conséquence indirecte de l’affaire, le requérant Jacques Lalié a donc repris son siège au congrès sans attendre, le Conseil constitutionnel ayant finalement confirmé l’analyse proposée par le juge des référés du Conseil d’Etat.
À n’en pas douter, cette affaire témoigne qu’en dépit de leur proximité géographique, les juges des deux ailes du palais royal n’arrivent pas toujours à se comprendre lorsqu’il s’agit de se transporter à l’autre bout du monde en plein cœur du particularisme néocalédonien. L’ironie de l’histoire est qu’à quelques jours près, on notera des divergences similaires en ce qui concerne le gel du corps électoral spécial, conforté par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2025-1163/1167 QPC tandis que le Conseil d’Etat dans son avis du 26 décembre 2023 l’avait à l’inverse nettement contesté, y compris sur le plan de sa constitutionnalité.
Zérah Brémond
Maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour