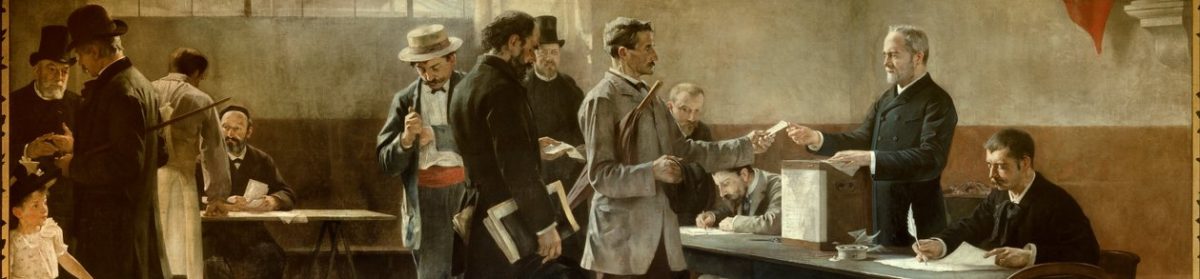Comparaison n’est pas raison, mais le retour sur la situation roumaine aujourd’hui permet de mettre en perspective que les rapports entre les élections et les juges ne sont jamais simples. Vous trouverez ci-dessous une analyse exhaustive de l’annulation de l’élection présidentielle roumaine en décembre 2024 par Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, Maître de conférences associée, Directrice-adjointe de l’Institut Louis Favoreu, Aix Marseille Université, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France. Un grand merci à elle pour sa participation au blog du droit électoral !
*****
« C’est le moment où l’État roumain a bafoué la démocratie. Dieu, la vérité, le peuple roumain et la loi prévaudront. Il ne s’agit pas de moi. L’économie s’effondre, vous détruisez la démocratie, vous conduisez le pays à l’anarchie. Nous aurions dû organiser le vote et respecter la volonté du peuple roumain. […] Les présidents ne sont pas nommés par le biais de négociations en coulisses dans une démocratie. Je sais que j’aurais gagné et que je gagnerai, car le peuple roumain sait que je me battrai pour lui, que j’assurerai son union pour une Roumanie meilleure. Je condamne fermement ce qui s’est passé aujourd’hui. Ils [les juges constitutionnels] ont détruit tout ce qui a été obtenu avec tant de difficultés au cours des trente-cinq dernières années. La décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie est illégale, immorale et anéantit l’essence même de la démocratie : le vote »[1]. C’est par cette déclaration qu’Elena Lasconi, la candidate pro-européenne à l’élection présidentielle a exprimé son désaccord avec l’arrêt que la Cour constitutionnelle venait de prononcer le 6 décembre 2024[2], annulant les résultats du premier tour de l’élection, ordonnant la reprise du processus électoral dans son intégralité et prolongeant le mandat du président sortant jusqu’à la tenue de nouvelles élections et la validation du mandat d’un nouveau président.
La surprise créée par cet arrêt, une première en Roumanie, a été à la hauteur de celle des résultats eux-mêmes du premier tour. Or, l’objet des sondages réalisés tout au long de la campagne électorale était simplement de savoir quel candidat allait avoir en face au second tour Marcel Ciolacu, le Premier ministre en exercice et membre du Parti social-démocrate (PSD). Personne n’a envisagé un autre scénario que celui d’un duel entre M. Ciolacu et un autre candidat qui de facto n’aurait eu aucune chance de remporter l’élection. Cet « autre candidat » ne pouvait nullement être incarné par Călin Georgescu. Celui-ci était tellement méconnu sur la scène politique roumaine que jusqu’à mi-novembre, il n’apparaissait même pas dans les sondages. C’est à partir du 14 novembre que son nom à commencer à y figurer, avec un taux d’intentions de vote variant entre 4 et 6 %. Le plus haut score lui ayant été attribué dans un sondage du 22 novembre 2024, deux jours avant le premier tour de l’élection, s’éleva à 10,6 %[3], bien inférieur à celui qu’il a finalement obtenu le jour du vote, c’est-à-dire 22,94 %[4].
Dans un arrêt qui brille par le laconisme de la motivation, pratique peu habituelle à la méthodologie généralement utilisée dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle roumaine justifie l’annulation de tout le processus électoral par le fait qu’il « a été entaché, tout au long de sa durée et à toutes les étapes, de multiples irrégularités et violations de la législation électorale qui ont faussé le caractère libre et équitable du vote des citoyens et l’égalité des chances des candidats aux élections, affecté la nature transparente et équitable de la campagne électorale et méconnu les règles légales relatives à son financement »[5]. Elle a pu parvenir à cette conclusion en se basant sur les cinq documents déclassifiés sur ordre du Président Iohannis, discutés lors du Conseil suprême de défense nationale[6] du 28 novembre 2024, lesquels attestaient d’actions massives de cyber acteurs étatiques et non étatiques sur les infrastructures informatiques et de communication dans le but d’influencer les résultats des urnes. L’analyse desdits documents aurait révélé qu’en violation de la législation électorale, le candidat Călin Georgescu aurait bénéficié d’une exposition massive en raison du traitement préférentiel que lui avait offert la plateforme TikTok. Notamment, l’absence de son identification comme candidat à l’élection présidentielle, du fait que ses vidéos de propagande électorale ne contenaient pas le numéro d’identification unique attribué par le Bureau électoral central, aurait augmenté de manière significative sa visibilité par rapport aux autres candidats reconnus par les algorithmes de TikTok comme candidats, ce qui aurait impliqué un filtrage massif du contenu vidéo qu’ils diffusaient et diminué, en conséquence, leur visibilité parmi les utilisateurs de la plateforme.
L’arrêt de la Cour du 6 décembre intervient toutefois à la suite d’un autre arrêt, prononcé le 2 décembre 2024[7], soit quatre jours plus tôt, validant au contraire les résultats du premier tour de l’élection. La Haute juridiction a certes motivé ce changement de position par les nouvelles informations qui lui avaient été communiquées à la suite de la décision du président de la République de déclassifier les cinq documents secrets transmis par les services de sécurité. Toutefois, sur le plan juridique, l’arrêt de la Cour n’est pas dépourvu de critiques, tant au niveau de la manière dont elle a exercé ses compétences (I) qu’à celui du contrôle exercé et des conséquences qu’il a pu ou pourrait produire (II).
I – L’exercice critiquable d’une compétence non autorisée par les textes
En vertu de l’article 146 lettre f) de la Constitution, la Cour constitutionnelle « veille au respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du suffrage ». L’article 37 de la loi n° 47/1992 du 18 mai 1992 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle reprend les dispositions constitutionnelles sans apporter d’autres précisions. C’est dans le cadre de l’exercice de cette compétence que la Cour a validé, par l’arrêt n° 31 en date du 2 décembre 2024, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, n’ayant constaté, « après examen des procès-verbaux d’enregistrement et de centralisation des résultats du vote […] des irrégularités de nature à infirmer le résultat établi »[8].
Dans cet arrêt, la Cour fait référence à deux décisions rendues à la suite de saisines déposées par deux candidats en lice, M. Sebastian-Constantin Popescu et M. Cristian-Vasile Terheș, en application de l’article 52 alin. 1) de la loi n° 370/2004[9], selon lequel la Haute juridiction « annule les élections si le scrutin et l’établissement des résultats ont eu lieu au moyen de fraudes de nature à modifier l’attribution du mandat ou, le cas échéant, l’ordre des candidats participant au second tour du scrutin. Dans ce cas, la Cour ordonnera une répétition du scrutin le deuxième dimanche après la date de l’annulation des élections ». Selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 du même article, « la demande d’annulation des élections peut être formulée par les partis politiques, les alliances politiques, les alliances électorales, les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales représentées au Conseil des minorités nationales et par les candidats ayant participé aux élections, dans un délai maximum de 3 jours à compter de la clôture du scrutin ».
Dans les deux saisines, étaient demandées l’annulation des résultats du premier tour et l’invalidation du résultat électoral obtenu par le candidat indépendant Călin Georgescu du fait que ce dernier avait violé la loi n° 334/2006 sur le financement de l’activité des partis politiques et des campagnes électorales, avait caché les sources de financement de sa campagne électorale, avait trompé l’électorat à travers une campagne massive en ligne. La saisine du candidat Sebastian-Constantin Popescu a été rejetée par la Cour constitutionnelle par la décision n° 29 du 28 novembre 2024 pour tardiveté[10]. En revanche, celle de M. Cristian-Vasile Terheș a été rejetée au fond pour absence d’éléments prouvant la véracité de ses déclarations. Cette décision a été rendue le 2 décembre 2024.
En plus de ses arguments initiaux, rejetés pour « défaut de preuve », l’auteur de la saisine a aussi invoqué la réunion du Conseil suprême de défense nationale du 28 novembre 2024, en demandant à la Cour à ce que les éléments d’analyse de celui-ci soient pris en compte. La Cour a rejeté la demande du fait que ladite analyse ne portait pas sur les aspects concrets du vote et de l’établissement des résultats : « concernant la possibilité de demander l’analyse du Conseil suprême de défense nationale du 28 novembre 2024, en référence aux éventuels risques pour la sécurité nationale générés par les actions des acteurs cybernétiques étatiques et non étatiques sur les infrastructures IT&C, soutenant le processus électoral, il a été démontré que cela n’est admissible que si l’analyse concerne des aspects concrets concernant le vote et l’établissement des résultats qui auraient pu se produire par fraude susceptible de modifier l’attribution du mandat ou, le cas échéant, l’ordre des candidats qui peuvent participer au second tour de scrutin. ».
Trois jours plus tard, c’est-à-dire le 5 décembre 2024, la Cour a changé d’avis. Par un message a peine voilé adressé au cours d’une conférence de presse, la Haute juridiction a en effet invité Elena Lasconi, la candidate en lice pour le second tour, à déposer une saisine pour demander l’annulation des résultats de l’élection au regard des informations révélées à l’issue de la réunion du Conseil suprême de défense nationale. Rappelons toutefois que le délai de trois jours pour engager une saisine, tel que prévu à l’article 52 al. 2) de la loi n° 370/2004, était déjà expiré et que pour raison de tardiveté d’un jour la saisine de M. Popescu avait déjà été rejetée par la décision rendue le 28 novembre 2024. La candidate Elena Lasconi, convaincue de ses chances de victoire au second tour, n’a toutefois pas souhaité entendre le message de la Cour.
Cette dernière n’a donc eu d’autre choix que de s’auto-saisir pour pouvoir agir – alors même qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne le lui autorise – en procédant, une fois de plus et dans la continuité de sa jurisprudence qui commence à s’étoffer en la matière, à une interprétation extensive de sa compétence issue de l’article 146 lettre f) de la Constitution. Cette technique interprétative lui a permis, par exemple, de se déclarer compétente, dans un arrêt prononcé le 14 octobre 2024[11], pour trancher au fond tous les litiges nés d’incidents pouvant survenir lors de la procédure d’élection du président de la République. Elle a ainsi accepté de contrôler la légalité d’une décision du Bureau électoral central, bien que la nature administrative de cet organe et des actes qu’il émet ne fassent pas de doute et que le contentieux administratif relève de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. À cette occasion, elle a aussi admis qu’une exception d’inconstitutionnalité soit soulevée directement devant elle, alors que, conformément à sa jurisprudence antérieure, un filtre doit obligatoirement être réalisé par les juges ordinaires. La juge Elena-Simina Tanasescu, qui est aussi une Professeure reconnue de droit constitutionnel, a rédigé une opinion séparée pour exprimer son désaccord avec l’interprétation retenue par les juges majoritaires.
La même technique interprétative a permis à la Cour d’élargir la liste des conditions s’imposant aux candidats à l’élection présidentielle[12], prévues à l’article 37 de la Constitution et à l’article 27 de la loi n° 370/2004. La candidature de Diana Iovanovici-Șoșoacă, l’eurodéputée d’extrême droite, a ainsi pu être rejetée en raison de son « discours anticonstitutionnel » et son « comportement antidémocratique », tels qu’appréciés par la Cour au regard de différentes déclarations qu’elle a pu faire à partir de 2021. Dans son opinion séparée, la juge Laura Iuliana Scântei a rappelé que la Cour, dans toute sa jurisprudence antérieure, a vérifié uniquement le strict respect des conditions légales objectives prévues à l’article 37 de la Constitution et aux articles 27 et 28 de la loi n° 370/2004, telles que le respect du délai d’enregistrement de la candidature, du nombre de signatures requis en soutien de la candidature, de la présence des actes obligatoires requis à l’appui de la candidature, de l’existence d’éventuelles interdictions limitativement prévues par la Constitution et les lois. Au regard du cadre normatif en vigueur, le contrôle de la Cour ne peut, en aucun cas, dériver vers un contrôle subjectif d’appréciation de la « qualité du candidat », de ses opinions, déclarations politiques ou comportements antérieurs non sanctionnés par une décision de justice devenue définitive. La position de la juge Scântei, qui fait partie des quatre juges sur les neuf formant la Cour qui s’étaient opposés à la solution finalement retenue, met en exergue les dissidences existant au sein de la juridiction sur la question des limites du contrôle que celle-ci doit exercer dans le cadre du processus d’élection du président de la Roumanie.
Dans l’arrêt du 6 décembre 2024, la Cour a toutefois décidé de continuer son activisme jurisprudentiel en se déclarant ex officio compétente pour exercer un nouveau contrôle de la régularité du processus électoral en dehors de toute saisine, seul cas prévu à l’article 52 alin. 1) de la loi n° 370/2004.
A-t-elle eu une autre alternative pour agir dans le respect des prescriptions constitutionnelles et législatives ?
La réponse est positive : elle aurait notamment pu intervenir après le second tour, qui avait d’ailleurs déjà commencé au moment où l’arrêt du 6 décembre a été prononcé. En effet, la candidate Elena Lasconi aurait pu, en vertu de l’article 52 de la loi n° 370/2004, contester les résultats des urnes si elle avait perdu face à son concurrent. Cette solution aurait été respectueuse du cadre normatif en vigueur, aurait permis aux autorités publiques de surveiller plus attentivement les outils de communication utilisés par le candidat Georgescu, de réaliser des investigations supplémentaires et de préparer ainsi des preuves solides qui auraient été audibles pour les électeurs. Le choix fait par la Cour s’explique probablement par sa volonté d’éviter les tensions politiques et sociales qu’aurait généré l’annulation du second tour de l’élection. Compte tenu des incertitudes qui dominent la vie politique roumaine actuelle et le résultat incertain des urnes lors de l’élection prévue en mai prochain, il n’est pas sûr que l’objectif visé soit atteint. En revanche, la réputation et la légitimité sociale de la Haute juridiction sont affaiblies en raison des critiques qui peuvent légitimement être formulées à l’encontre de son arrêt du 6 décembre.
Les décisions de rejet des requêtes adressées par Călin Georgescu à la Cour européenne des droits de l’homme et au Tribunal de l’Union européenne, pour cause d’incompétence justement[13], devraient être retenues comme une leçon de droit par la Cour constitutionnelle roumaine, ainsi que par les juges électoraux des autres États membres. Les juges européens ont en effet choisi d’interpréter strictement leur domaine de compétence, en rappelant qu’une différenciation doit être faite entre la fonction de juge et le rôle de justicier. La Cour constitutionnelle roumaine a choisi le rôle à la place de la fonction, choix périlleux pour la démocratie constitutionnelle qu’elle déclare pourtant vouloir protéger.
II – La mise en péril des valeurs fondamentales de la démocratie constitutionnelle
La lecture de l’arrêt du 6 décembre étonne par le caractère succinct de sa motivation, qui de plus contient de nombreuses répétitions formulées simplement de manière différente. Preuve de la difficulté que la Cour a eue pour justifier juridiquement sa position. En outre, une bonne partie des motifs porte sur les lacunes dont souffre le cadre normatif électoral en vigueur et son incapacité à faire face aux nouveaux défis que pose le développement de l’intelligence artificielle. Elle fait mention de l’implication de certaines plateformes numériques et de leurs mécanismes de promotion du contenu électoral, qui ont été utilisés pour amplifier les messages de désinformation ou pour favoriser un candidat par rapport à d’autres. À ce titre, la Cour fait référence au concept de « neutralité électorale »[14], indiquant que l’obligation de son respect s’étend non seulement aux autorités publiques, mais également aux acteurs privés qui jouent un rôle important dans le processus électoral. Les juges constitutionnels proposent quelques orientations générales pour l’avenir, en soulignant le besoin urgent d’une réforme de la législation électorale. Parmi les recommandations incluses dans l’arrêt figurent :
- la révision de la réglementation relative au financement des campagnes électorales, avec un accent sur la transparence et un contrôle plus strict des sources de financement ;
- la création d’un cadre juridique pour surveiller et lutter contre l’ingérence numérique dans les élections, notamment par le biais d’une collaboration avec les plateformes de médias sociaux ;
- l’amélioration des mécanismes de vérification des candidats, pour éviter les situations dans lesquelles des personnes impliquées dans des activités illégales ou inconstitutionnelles sont acceptées comme candidats éligibles.
Dans la perspective des deux tours de l’élection présidentielle prévus pour les 4 et 18 mai prochains, aucune modification du cadre normatif pour assurer le respect des recommandations de la Cour n’a été enregistrée à ce jour. Sur le plan normatif, aucune leçon n’a donc été tirée d’une décision qui a annulé le vote de plus de 9,2 millions d’électeurs. Les lacunes normatives relevées par la Haute juridiction soulèvent aussi la question du fondement de l’annulation de l’élection. Il est notamment reproché au candidat Georgescu de ne pas avoir respecté le cadre légal, alors que celui-ci ne contient justement aucune réglementation visant l’utilisation des plateformes numériques dans le cadre des campagnes électorales. Une sanction donc infligée en l’absence de base légale.
En outre, l’annulation totale du processus électoral n’a pas eu d’impact sur le candidat fautif uniquement, mais également sur la situation d’Elena Lasconi qui a été purement et simplement privée de la chance de devenir peut-être la première présidente de la Roumanie. Dans le souci d’assurer la garantie du droit d’être élue, dont Mme Lasconi bénéficie en vertu de l’article 37 de la Constitution et à qui aucun reproche n’a été fait en matière de respect de la réglementation électorale, la Cour constitutionnelle aurait pu annuler le résultat obtenu par le candidat Georgescu, laissant l’accès au second tour aux candidats placés en deuxième et troisième positions, c’est-à-dire à Mme Lasconi et à M. Ciolacu. La décision d’annuler le processus électoral dans sa totalité apparaît donc comme disproportionnée au regard des atteintes portées aux droits des autres candidats, en l’absence d’éléments matériels prouvant la commission de possibles violations de la réglementation électorale par ces derniers, tout comme au droit de vote des électeurs garanti à l’article 36 de la Constitution.
De facto, ces éléments matériels sont sujets à débat dans le cas du candidat Georgescu également. La Cour explique, au point 5 de l’arrêt, avoir simplement « pris note » du contenu des cinq documents qui lui ont été communiqués à la suite de la réunion du Conseil suprême de défense nationale du 28 novembre 2024. Par la suite, au point 7, les juges affirment que le contenu desdits documents prouve que l’ingérence « a non seulement vicié le processus électoral, mais a cherché à le détourner de manière systématique et intentionnelle, dans le but de compromettre les valeurs fondamentales de la démocratie constitutionnelle. […] En ce sens, l’implication directe ou indirecte d’entités étrangères représente une menace majeure et le rôle des institutions étatiques, y compris de la Cour constitutionnelle, est de prévenir de telles vulnérabilités ». En l’absence de détails concrets, il est impossible d’apporter une quelconque appréciation à ces affirmations. Force est toutefois de constater que ces documents, qui sont des notes informatives des services d’information et de sécurité, n’ont entraîné aucune mesure d’ordre politique ou de sécurité entre le jour où s’est tenue la réunion du Conseil, le 28 novembre, et la date de la prononciation de l’arrêt par la Cour, le 6 décembre, alors que ces dites notes auraient identifié, tel que l’indiquent les juges constitutionnels, des risques majeurs pour la sécurité nationale.
Ces constats, ainsi que le manque de transparence que l’on découvre à la lecture de l’arrêt de la Cour nourrissent les discours populistes et ont conduit à l’établissement d’un climat de défiance généralisée de la part des citoyens à l’égard des institutions. Les photographies des juges constitutionnels, considérés comme des traitres par les soutiens de Călin Georgescu, restent affichées en permanence devant le bâtiment de la Cour à Bucarest. Dans ce contexte de crise politique et citoyenne, le Président Iohannis n’a trouvé rien de mieux comme idée que de décorer, le 10 février 2025, le président de la Cour constitutionnelle et deux autres juges constitutionnels – notons au passage que les juges ayant émis des opinions discordantes dans certaines décisions discutables ne se trouvent pas parmi les décorés – « en signe de haute appréciation de la compétence et du haut professionnalisme prouvés dans le domaine de la justice constitutionnelle, pour l’activité de garantie de la suprématie de la Constitution, de ses valeurs et du parcours démocratique de l’État roumain »[15].
Le respect des valeurs de la démocratie et de l’État de droit par la Cour roumaine a été justement questionné dans le rapport urgent rendu par la Commission de Venise le 25 janvier 2025 à la demande du Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à la suite de l’arrêt du 6 décembre dernier[16]. Tout en prenant les précautions d’indiquer qu’il ne leur appartient pas « d’examiner les faits de l’affaire, ni d’examiner la décision de la Cour constitutionnelle »[17], les auteurs du rapport ont émis, de manière indirecte, de nombreuses réserves, voire critiques, à l’égard de l’arrêt de la Cour, relevant notamment le caractère insuffisant de sa motivation qui, compte tenu de la saisine ex officio – non autorisée par la loi, est-il précisé – doit contenir les éléments de preuve sur lesquels l’annulation est fondée, ainsi que l’explication claire des raisons pour lesquelles les juges sont convaincus que les irrégularités ont pu avoir un impact sur le résultat[18].
Concernant le type d’éléments de preuve, la Commission précise que les décisions juridictionnelles « ne doivent pas être fondées uniquement sur des renseignements classifiés (qui ne peuvent être utilisés qu’à titre d’informations contextuelles), car cela ne garantirait pas la transparence et la vérifiabilité nécessaires ». Or, nous l’avons dit plus haut, toute la motivation de l’arrêt de la Cour roumaine du 6 décembre 2024 repose sur les cinq documents déclassifiés. La Commission précise aussi que « le simple fait qu’un candidat réussisses sa campagne en ligne et que l’utilisation des plateformes de médias sociaux puisse amplifier le message d’un candidat au-delà de ce qui était possible avec les médias imprimés et radiodiffusés ne signifie pas que le candidat a violé les règles relatives aux dépenses de campagne et à la transparence et qu’il a donc obtenu un avantage injuste. Le rôle du juge est d’examiner si des règles ont été violées en recevant un soutien de campagne de la part de tiers, que ce soit en ligne ou non ». Dans l’arrêt du 6 décembre, la Cour constitutionnelle affirme, au contraire, que l’amplification de la campagne électorale obtenue par le candidat à travers les réseaux sociaux et autres supports constituait la principale cause de violation des règles électorales.
De même, en ce qui concerne le financement, la Haute juridiction fait à plusieurs reprises référence aux notes d’informations déclassifiées révélant « le financement de sources non-déclarées de la campagne électorale, y compris en ligne », informations qui contredisent celles communiquées par le candidat Georgescu à l’Autorité électorale permanente, attestant de l’absence de dépenses électorales. Ceci lui permet de conclure, au point 19 de l’arrêt, que « les incohérences flagrantes relevées méconnaissent le principe de transparence du financement de la campagne électorale et entraînent des suspicions quant à la régularité du déroulement de l’élection ». Il est étonnant que la déclaration d’absence totale de dépenses électorales pour une élection présidentielle n’ait pas attiré l’attention des juges constitutionnels au moment de la validation, le 2 décembre 2024, des résultats du premier tour.
En outre, dans le contexte du scandale politique créé par l’arrêt du 6 décembre, toutes les structures de l’État ont été saisies pour effectuer des vérifications relevant de leur domaine d’action (ce qu’elles auraient dû faire pour prévenir de telles dérives). À la suite des premières vérifications, l’Agence nationale d’administration fiscale a rendu publiques des informations selon lesquelles le Parti national-libéral (PNL) aurait versé des sommes importantes d’argent à une société qui a massivement promu la candidature de Călin Georgescu[19], le but étant de disperser les voix vers de « petits candidats » pour affaiblir le Premier ministre Ciolacu (candidat du PSD) et l’empêcher ainsi de gagner l’élection.
Comme on a pu le constater par la suite, le soutien apporté à M. Georgescu a dépassé les attentes du PNL. Même si ces informations sont connues depuis fin décembre 2024, aucune sanction à l’encontre de ce parti n’a été prise à ce jour, alors qu’il s’agit d’une violation grave des règles électorales, et le candidat soutenu par le PNL (qui entre temps a fait alliance avec le PSD) n’a pas été empêché d’enregistrer sa candidature auprès du BEC en vue de l’élection du 4 mai prochain, tel que fut le cas pour M. Georgescu[20]. Cette différence de traitement, avec tous les événements qui animent la scène politique et juridictionnelle roumaine depuis octobre 2024, sont interprétés comme « un coup d’État » monté par la mafia au pouvoir et alimentent le discours de l’extrême droite qui ne fait que progresser dans les sondages.
En effet, selon les sondages actuels[21], le candidat d’extrême droite, George Simion (candidat commun du parti AUR et POT) bénéficie de 30 % d’intentions de votes, la deuxième place étant partagée entre Crin Antonescu (PSD+PNL+UDMR) et Nicușor Dan (candidat indépendant) en fonction des sondages, avec 21-23 %. Elena Lasconi se place loin derrière, avec 8 à 12 % d’intentions de vote. L’expérience de l’élection de novembre 2024 montre que les chiffres des sondages doivent être interprétés avec beaucoup de précautions. Compte tenu du constat de la montée nette de la popularité du candidat d’extrême droite, la situation n’est pas pour autant moins inquiétante et oblige à s’interroger sur la protection effective de la démocratie et de l’État de droit que l’arrêt du 6 décembre dernier de la Cour est censé avoir garanti et sur ses possibles conséquences néfastes, qui peuvent s’avérer des années plus tard ?
En 1996, le monde occidental se réjouissait de la réélection de Boris Eltsine en tant que président de la Fédération de Russie face au communiste Gennady Zyuganov, tout en sachant, et l’ayant reconnu publiquement par la suite, qu’il y avait eu une fraude électorale massive. Les résultats de l’élection ont été reconnus car le retour d’un communiste au pouvoir était inconcevable. Fut-ce une bonne décision de méconnaître le vote du peuple ? Dans l’immédiat peut-être oui. Sur le long terme, on connaît le résultat. Le cours de l’histoire de la Russie aurait peut-être tourné autrement si le peuple russe avait été écouté.
*
***
Quelle serait alors la solution ? Laisser sûrement le peuple choisir en âme et conscience, tout en veillant au respect strict de la règle de droit, par tous : citoyens, responsables politiques et juges.
La vie politique roumaine est tellement riche en faits divers que la page de l’élection de 2024 va être rapidement tournée, si celle de mai 2025 finit par un résultat pacifiant une société plus divisée que jamais. A contrario, l’image de la Cour constitutionnelle restera durablement impactée, en raison précisément des précédents créés par ses nombreuses décisions rendues depuis octobre 2024 et des risques d’instrumentalisation dont elles pourraient faire l’objet en fonction des majorités politiques au pouvoir.
Le cas roumain a certainement mis en évidence la non-adaptation des législations électorales aux nouveaux défis que pose le développement de l’intelligence artificielle en termes de contrôle et de manipulation de l’opinion publique, d’ingérences externes dans les processus électoraux. Le rôle du juge constitutionnel, ses pouvoirs et limites d’actions doivent également être questionnés compte tenu des risques de politisation et d’instrumentalisation majeurs qui fragilisent leur image et leur légitimité, alors que l’importance de leur action ne soulève pas de doute dans le contexte des menaces que présentent pour nos démocraties les mouvements populistes et illibéraux qui se multiplient et se renforcent.
Les interrogations doivent également porter sur la culture politique des électeurs, le rôle des médias et la qualité des informations proposées et, surtout, sur l’exemplarité de la classe politique. Le vote du peuple roumain n’a pas été le résultat des influences et malversations externes uniquement. Il s’est aussi agi du rejet d’un système politique gangréné par la corruption depuis trente ans. Rejet bloqué par une Cour constitutionnelle censée protéger les droits et libertés, y compris politiques, des citoyens. C’est justement pour cette raison que les décisions rendues par la Haute juridiction sont contestées et interprétées comme un moyen détourné de muselage sous couvert de vouloir protéger la démocratie et l’État de droit. Au lendemain de la prononciation de l’arrêt du 6 décembre, le politologue roumain Alexandru Gussi regrettait les prises de position de la Cour constitutionnelle, en rappelant que « rien n’est plus périlleux qu’une foule humiliée et sans alternative »[22]. Espérons que cette mise en garde ne sera pas concrétisée par les résultats des urnes en mai prochain.
Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI
Maître de conférences associée, Directrice-adjointe de l’Institut Louis Favoreu,
Aix Marseille Université, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

[1] Déclaration en langue roumaine : https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/elena-lasconi-dupa-ce-curtea-constitutionala-a-anulat-alegerile-prezidentiale-statul-roman-a-calcat-in-picioare-democratia-3036327.
[2] CC, arrêt n° 32 du 6 décembre 2024.
[3] Pour les résultats des sondages et leur évolution, voir : https://stirileprotv.ro/alegeri/prezidentiale/2024/alegeri-prezidentiale-2024-ce-spuneau-sondajele-de-opinie-despre-candidati-in-urma-cu-6-luni-si-ce-arata-acum.html
[4] Elena Lasconi a obtenu 19,18 % et Marcel Ciolacu, favori des sondages, a obtenu 19,15 % des voix, se plaçant en troisième position.
[5] Point 5 de l’arrêt.
[6] En roumain, « Consiliul Suprem de Apărare a Țării ». Le compte rendu de sa réunion du 28 novembre 2024 est disponible à l’adresse : https://csat.presidency.ro/ro/comuni/sedinta-consiliului-suprem-de-aparare-a-tarii1732806302.
[7] CC, arrêt n° 31 du 2 décembre 2024.
[8] Id., point 9.
[9] Loi n° 370/2004 du 20 septembre 2004 relative à l’élection du président de la Roumanie.
[10] Pour rejeter la saisine, la Cour a appliqué les dispositions de l’article 62 al. 1 de la loi n° 370/2004, qui prévoit que « Les délais en jours, prévus par la présente loi, comprennent le jour où ils commencent à courir et se terminent à 24 heures le jour où ils expirent, même s’il ne s’agit pas de jours ouvrables » M. Popescu a saisi la Cour le 27 novembre 2024, soit trois jours après la date de l’élection, alors qu’il aurait dû déposer sa saisine le 26 au plus tard, en raison de la prise en compte du jour de l’élection dans la détermination du délai de trois jours fixé par l’article 51 al. 2 de la même loi.
[11] CC, arrêt n° 21 du 14 octobre 2024.
[12] CC, arrêt n° 2 du 5 octobre 2024.
[13] TUE, 3 mars 2025, Călin Georgescu c. Roumanie et Commission européenne, ordonnance n° T-67/25 ;
Cour EDH, 6 mars 2025, Călin Georgescu c. Roumanie, req. n° 37327/24.
[14] Point 8 de l’arrêt n° 32 du 6 décembre 2024.
[15] Voir en roumain : https://www.news.ro/justitie/update-klaus-iohannis-i-decorat-presedintele-ccr-marian-enache-alti-doi-judecatori-curtii-constitutionale-competenta-inaltul-profesionalism-dovedite-domeniul-justitiei-constitutionale-parcursul-1922400010002025021021928930.
[16] Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Rapport urgent sur l’annulation des résultats des élections par les cours constitutionnelles, 22 p., CDL-PI(2025)001, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2025)001-f.
[17] Id., p. 3.
[18] Id., p. 13.
[19] Voir notamment : https://snoop.ro/anaf-a-descoperit-ca-pnl-a-platit-o-campanie-care-l-a-promovat-masiv-pe-calin-georgescu-pe-tiktok/.
[20] BCE, décision n° 18D du 9 mars 2025 ; CC, arrêt n° 7 du 11 mars 2025.
[21] Voir : https://www.euronews.ro/articole/sondaj-avangarde-alegeri-prezidentiale-2025-martie-george-simion-crin-antonescu-nicusor-dan.
[22] A. Gussi, « Hoții de iluzii democratice. Copilul aruncat cu apa din copaie », 7 décembre 2024, https://www.contributors.ro/hotii-de-iluzii-democratice-copilul-aruncat-cu-apa-din-copaie/.